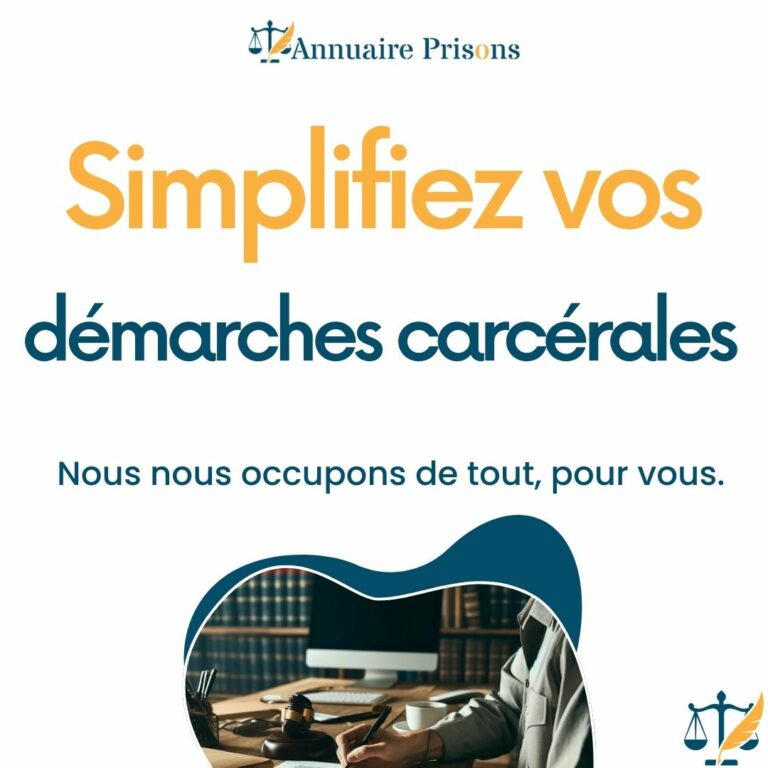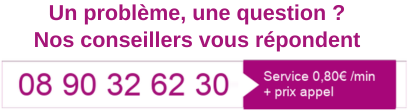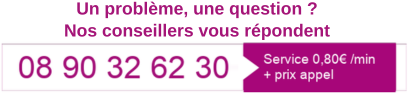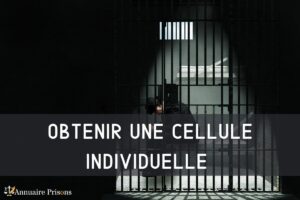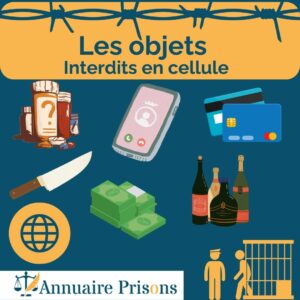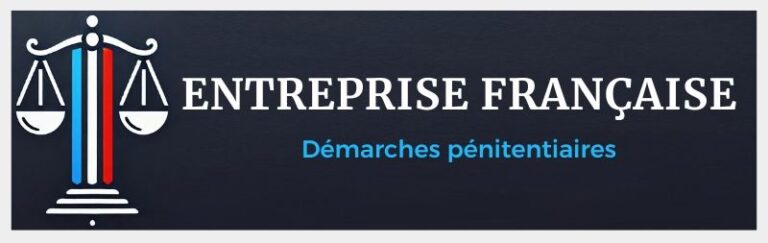Prison : Demander un changement de cellule
Accueil » Prison : Comment demander un changement de cellule ?
- Date de dernière mise à jour : 7 mai 2025
À l’heure où la plupart des établissements pénitentiaires sont concernés par la surpopulation carcérale, les droits des détenus à l’encellulement individuel sont constamment bafoués. Lors d’une incarcération, ces derniers sont parfois contraints de partager une cellule de quelques mètres carrés avec d’autres personnes écrouées, et l’entente n’est pas systématique. Découvrez sur cette page comment demander un changement de cellule lorsque le quotidien avec vos codétenus n’est plus vivable.

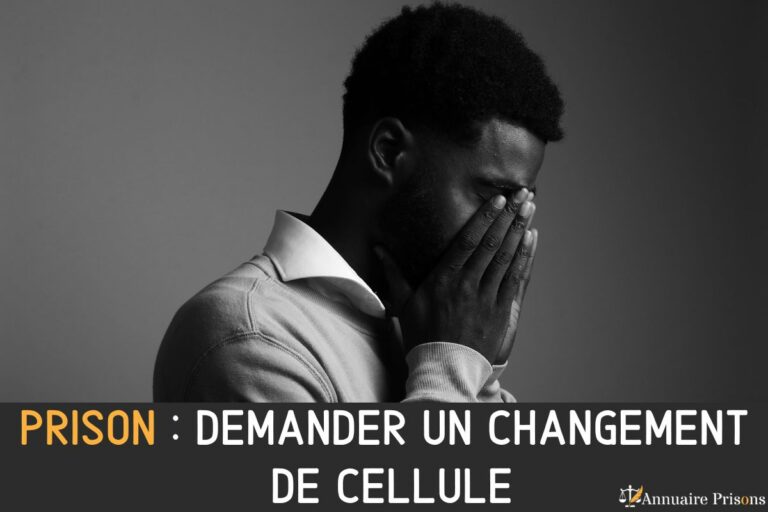
Démarches carcérales en ligne
À quoi ressemblent les cellules de prison en France ?
Pendant la nuit et au cours de certaines périodes de la journée, les personnes écrouées en France sont confinées dans la cellule à laquelle ils ont été affectés. À l’heure où les maisons d’arrêt et autres établissements pénitentiaires sont en état de surpopulation carcérale, les détenus doivent généralement partager ce maigre espace avec d’autres personnes condamnées ou en attente de jugement.
Les cellules des prisons françaises, d’une superficie comprise entre 9 et 19 m2, doivent être entretenue par leurs occupants. Les conditions de vie au sein d’une cellule sont particulièrement difficiles, notamment à cause du manque d’intimité et de la proximité avec les autres détenus.
Qui choisit l’affectation en cellule d’un détenu ?
Lorsqu’une personne est écrouée et affiliée à un établissement pénitentiaire en attente de son procès ou pour purger sa peine, c’est au directeur de la structure que revient le choix de son affectation en cellule. En fonction de différents critères, le détenu sera orienté vers une cellule collective ou individuelle pendant toute la durée de sa peine.
Depuis 2014, l’administration carcérale dispose d’un outil informatique nommé GENESIS, permettant de gérer plus efficacement l’affectation des détenus au sein d’une cellule. Il recense toutes les informations relatives aux personnes écrouées, l’identité de leurs codétenus ainsi que des l’historique des affectations et les observations faites par les surveillants et optimise ainsi les choix faits par la direction de l’établissement pénitentiaire chargé d’affecter les détenus.
Critères d’affectation des détenus en cellule
Lorsqu’il s’agit d’affecter un nouvel arrivant à une cellule déjà occupée par d’autres détenus, la direction de l’établissement pénitentiaire se base sur différents critères :
- L’âge de la personne écrouée, sa langue, son état de santé physique et mentale ;
- Sa situation carcérale : prévenu ou condamné, primaire ou récidiviste, mineur ou majeur ;
- Son éventuelle addiction au tabac ;
- Et ses connaissances au sein de la prison.
Notez qu’à l’heure où les cellules de prison sont surpeuplées, il n’est pas rare de voir ces règles être bafouées et un détenu être affecté à une cellule inadaptée, simplement par manque de place.
Peut-on contester une affectation en cellule ?
La décision d’affectation en cellule d’un détenu relève uniquement du chef d’établissement et ne peut par conséquent être remise en question. Seul un motif légitime peut permettre à une personne écrouée d’être transférée vers une autre cellule.

Les règles de séparation dans le cadre d’une affectation en cellule
Même si elles ne sont que très rarement respectées, des règles de séparation contraignent normalement les directeurs d’établissements pénitentiaires à faire des choix judicieux lorsqu’il s’agit d’affecter un détenu à une cellule :
- Les personnes écrouées pour la première fois et les récidivistes doivent être séparées ;
- Les mineurs devenus majeurs en détention et qui ont moins de 21 ans ne doivent pas être affectés à une cellule au sein de laquelle se trouvent d’autres majeurs ;
- Les prévenus et condamnés ne doivent pas être mêlés ;
- Les personnes poursuivies pour la même affaire doivent être séparées…
Les droits des détenus sont-ils respectés ?
En 1875, la loi de l’encellulement individuel, droit fondamental des détenus, était promulguée, mais son application est sans cesse repoussée. La surpopulation carcérale pousse effectivement les autorités à modifier la loi, malgré le caractère contestable et dangereux de ces reports successifs.
En 2003, 2009, 2014, 2019 et 2022, le principe a effectivement été repoussé, et ce malgré les dénonciations faites par bon nombre de détenus, d’associations et d’autres acteurs du milieu carcéral.
Selon l’article 100 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, lorsqu’un détenu (prévenu ou condamné) est incarcéré au sein d’une maison d’arrêt dont la surpopulation ne permet pas de faire respecter ce droit, une demande de cellule individuelle peut être réalisée auprès de la maison d’arrêt la plus proche. Un transfert vers un établissement qui dispose de place pourra alors être effectué. Notez que les personnes :
- placées à l’isolement ;
- concernées par une interdiction de communiquer ;
- ou encore victimes de violences de la part de leur codétenu sont prioritaires.
Les difficultés rencontrées au sein d’une cellule collective
Le quotidien en cellule, lorsqu’on partage quelques mètres carrés avec d’autres détenus, est particulièrement difficile. En plus de devoir cohabiter avec un voire plusieurs inconnus, les personnes écrouées doivent composer avec leurs habitudes et leurs caractères, et ce, de jour comme de nuit. L’espace confiné, l’enfermement et le manque d’intimité donnent souvent lieu à des litiges entre codétenus :
- Des disputes au sujet de l’entretien de la cellule ;
- De la nourriture ou des cigarettes cantinées ;
- Du bruit, des ronflements, des odeurs ;
- Ainsi que de nombreuses violences rendent difficile le quotidien au sein des cellules partagées.
Un détenu peut-il demander un changement de cellule ?
Si la situation n’est plus vivable et que des éléments prouvent qu’un détenu est en danger au sein de sa cellule, un changement de cellule peut être envisagé. Il faut toutefois détenir des preuves ou des arguments solides pour obtenir un déménagement parfois difficile à mettre en œuvre lorsque toutes les cellules sont occupées.
Comment demander un changement de cellule ?
Une demande de changement de cellule peut être formulée à l’écrit ou à l’oral, directement auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire, de son adjoint, d’un officier, d’un major ou encore d’un premier surveillant.
Cette requête doit être immédiatement prise en considération tandis que son caractère potentiellement urgent devra donner lieu aux démarches nécessaires pour organiser le transfert du demandeur vers une autre cellule.
Une demande de changement de cellule peut-elle être refusée ?
Si les éléments dénoncés par le détenu souhaitant changer de cellule ne sont pas considérés comme urgents, la demande de changement de cellule pourra être refusée. Seuls les motifs légitimes peuvent donner lieu à un tel transfert.
Recours en cas de refus de changement de cellule
Les demandes de changement de cellule sont particulièrement prises au sérieux au sein des prisons françaises et il convient de garder une trace écrite de telles requêtes et d’être en mesure d’identifier l’auteur de la décision à tout moment.
En cas de refus de changement de cellule, aucun recours n’est possible, mais des poursuites pourront être engagées contre le gradé ayant refusé la demande en cas de problèmes ultérieurs.
Situations urgentes pour un changement de cellule immédiat
Les violences et les difficultés à s’entendre avec un codétenu ne sont pas les seuls motifs légitimes pour formuler une demande de changement de cellule. En effet, les personnes écrouées ayant des idées suicidaires ou des besoins spécifiques en raison d’un handicap et celles vivant leur période d’incarcération dans des conditions d’insalubrité (présence de rats à proximité ou dans la cellule, dégât des eaux, moisissures, pièces mal chauffée ou trop exposée au soleil en été…) doivent pouvoir être transférées rapidement vers un encellulement individuel ou dans une pièce qui répond aux droits fondamentaux des détenus.
Prévention des dangers en cellule par l’administration pénitentiaire
Régulièrement, des fouilles ont lieu au sein des cellules afin d’éviter que des objets tranchants ou dangereux ne circulent et ne mettent en danger la vie des détenus. Aussi, les personnes écrouées sont régulièrement inspectées et interrogées en cas de traces de coup ou de blessures suspectes.
Des violences ayant lieu au sein d’une cellule sont généralement décelées par les surveillants. Ils doivent d’agir rapidement pour organiser le transfert des détenus malmenés vers une autre cellule.
"La liberté ne peut être que toute la liberté ; un morceau de liberté n'est pas la liberté."
Max Stirner

Questions les plus posées au sujet de l’affectation en cellule
Quel est le nombre maximum de détenus au sein d’une cellule ?
En principe, les cellules les plus petites sont conçues pour accueillir un seul détenu, mais il n’est pas rare de voir deux à trois personnes écrouées à l’intérieur. Malgré des aménagements insuffisants, des matelas sont posés à même le sol pour permettre aux détenus de dormir mais ces derniers subissent des conditions de vie particulièrement précaires.
Certaines cellules dites collectives peuvent quant à elle accueillir jusqu’à 4 à 5 personnes écrouées. Vivre au sein de ces dernières est particulièrement difficile puisqu’il convient de s’entendre avec davantage de codétenus pour éviter litiges et violences.
Les détenus passent-ils toute leur journée en cellule ?
Pour éviter d’être trop longtemps confinés au sein de leur cellule, les détenus peuvent participer à des activités organisées par l’administration pénitentiaire (sport, activités culturelles, religieuses, bibliothèque…) et rejoindre chaque jour la cour de promenade. Dans certains établissements, les portes des cellules restent closes en permanence tandis que dans d’autres, les personnes écrouées sont libres durant la journée de se déplacer au sein de la prison.
Très souvent, les détenus regardent la télévision dans leur cellule, pour passer le temps.
Quels sont les problèmes liés à la surpopulation carcérale ?
Les détenus qui vivent la majeure partie du temps au sein d’une cellule collective surpeuplée se heurtent à de réelles difficultés. En plus de favoriser les disputes, les violences, le racket et les litiges, une telle proximité peut donner lieu à la propagation de maladies, à la naissance de troubles mentaux et aller jusqu’au meurtre ou au suicide.
Quels sont les établissements pénitentiaires les plus touchés par la surpopulation carcérale ?
Certaines prisons françaises voient leur taux d’occupation dépasser les 200 %. Au sein de ces établissements, les détenus sont parfois contraints de dormir sur un matelas d’appoint, posé à même le sol et de partager des cellules de moins de 9 m 2 avec un, voire deux codétenus.
C’est notamment le cas des établissements pénitentiaires qui se trouvent à Mayotte, Nîmes, Rochefort, ou encore Foix où 2 500 personnes écrouées vivent leur incarcération dans des conditions indignes.