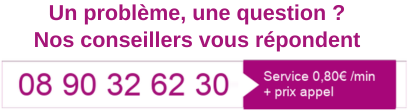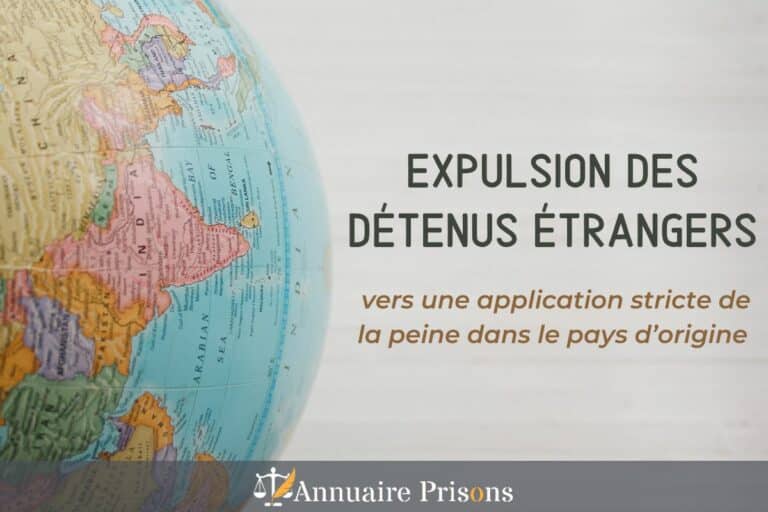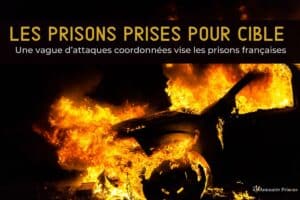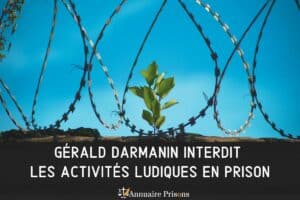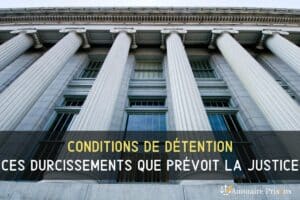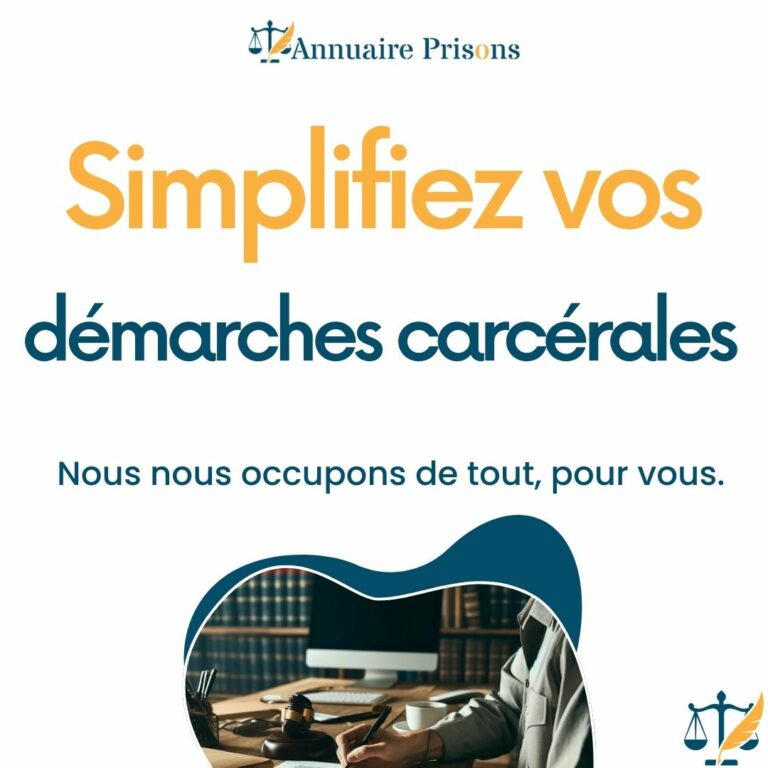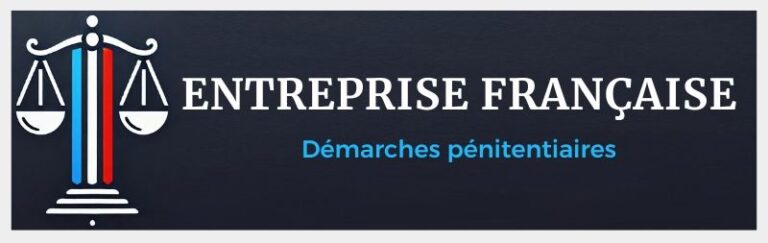Depuis quelques jours, une circulaire signée par Gérald Darmanin secoue le monde carcéral français. Le ministre de l’Intérieur réclame aux procureurs et aux directeurs d’établissement pénitentiaire de repérer systématiquement les détenus étrangers pouvant être expulsés. Objectif : qu’ils purgent leur peine dans leur pays d’origine. Une décision qui divise, surtout du côté des familles de détenus.
« Ce n’est pas parce qu’un détenu est étranger qu’il n’a pas ici des attaches solides, une compagne, des enfants ou simplement le soutien d’une famille présente en France ou dans un pays voisin », témoigne Pauline, chargée d’accompagnement au sein du site Annuaire-prisons.fr, qui assiste quotidiennement les proches de personnes incarcérées.
Une volonté politique claire
Le message du gouvernement est sans ambiguïté : désengorger les prisons françaises en faisant exécuter les peines à l’étranger. Selon Gérald Darmanin, cette mesure vise « l’efficacité » et la « fermeté ». Environ 16 000 détenus de nationalité étrangère sont actuellement incarcérés en France, soit près de 20 % de la population carcérale. La circulaire exige un repérage proactif de ceux dont la situation juridique permet une expulsion.
Cette politique repose sur des accords bilatéraux de transfèrement entre la France et certains pays. Mais dans les faits, peu de transferts sont réalisés chaque année : en 2023, seuls 252 transferts ont été exécutés, faute de coopération ou de conditions de détention jugées acceptables dans les pays d’origine.
Une mesure complexe à appliquer
En théorie, faire purger une peine dans le pays d’origine du détenu semble logique. Mais en pratique, cela soulève des questions juridiques, humaines et diplomatiques. Certains pays refusent tout simplement de récupérer leurs ressortissants, d’autres n’ont pas d’accord de transfèrement avec la France.
De plus, tous les détenus étrangers ne sont pas isolés. Au contraire, de nombreuses familles vivent en France ou dans d’autres pays européens et souhaitent rester en contact régulier avec le détenu. Chez Annuaire-prisons.fr, nous accompagnons régulièrement des familles vivant à l’étranger — notamment en Belgique, au Maroc ou en Espagne — qui demandent à ce que leur proche soit transféré plus près d’eux.
« Pour certaines mères, voir leur fils incarcéré dans un pays qu’il n’a pas connu depuis l’enfance est une vraie douleur. L’éloignement rend les démarches et les visites quasiment impossibles », ajoute Pauline.
Les proches oubliés dans le débat
Dans cette logique de fermeté, les familles sont les grandes oubliées. Beaucoup apprennent tardivement que l’expulsion est en cours. D’autres, surtout lorsque les démarches judiciaires sont en cours, se retrouvent perdues, sans informations ni recours clairs.
Nous pouvons aussi souligner que l’expulsion ne peut pas concerner les détenus en attente de jugement, les mineurs ou ceux bénéficiant d’un titre de séjour protégé. Mais ces distinctions sont parfois mal comprises, ce qui génère une insécurité administrative et psychologique supplémentaire pour les proches.
Quelles conséquences à long terme ?
Si la France parvient à appliquer cette politique de manière plus systématique, cela pourrait réduire légèrement la surpopulation carcérale. Mais cela ne réglera pas les problèmes structurels des prisons françaises : surpopulation, manque de personnel, vétusté des établissements.
Surtout, cette politique risque d’isoler encore plus certains détenus, coupés de tout lien social, ce qui peut compliquer leur réinsertion. Or, on le sait, l’absence de lien familial est un facteur aggravant pour la récidive.
Mais à l’inverse, l’expulsion peut aussi représenter une opportunité, notamment lorsque le détenu est transféré dans un pays où vivent ses proches. Être incarcéré dans un environnement familial peut alors favoriser le maintien du lien, l’accompagnement à distance et, à terme, une meilleure réinsertion.
La volonté du gouvernement d’expulser les détenus étrangers pour qu’ils purgent leur peine ailleurs est donc une mesure à double tranchant. Si elle semble répondre à une logique administrative, elle néglige encore trop souvent la réalité humaine : celle des familles, des enfants, des proches, parfois à des milliers de kilomètres, qui n’ont qu’un souhait — garder le lien. Une justice efficace, c’est aussi une justice qui n’oublie pas l’humain.
Sources : L’EXPRESS, Le Monde, Liberation